 |
L’instrument de musique dans la céramique de la Grèce antique Université de Lyon II Publication de la bibliothèque Salomon Reinach Daniel Paquette « extraits » |
Préface
…" c’est donc un champ considérable qui s’offre aux rares musicologues désireux d’aborder une telle investigation. Nous disons bien « musicologues » . Car , si la synthèse définitive devra bien un jour ou l’autre devenir une tâche collective où leur apport se fondra avec celui des hellénistes purs, des historiens, des archéologues, et peut-être d’autres encore, un tel syncrétisme serait sans doute prématuré tant que chacune de ces disciplines n’aura pas accompli, dans son domaine propre, le travail préliminaire sans lequel l’alliage terminal courrait le risque de craquer sous l’accumulation des pailles.
C’est dans cet esprit que, après avoir soutenu en 1968 à Dijon une thèse de troisième cycle dédiée principalement à l'utilisation des instruments de musique entre dieux et hommes d’après leur iconographie, Daniel Paquette put dix ans plus tard présenter avec succès devant un très ‘pluridisciplinaire ' jury de doctorat d’état à l’université de Paris-Sorbonne un travail considérable dont la présente publication ne constitue qu ‘un extrait..
....Quant aux musicologues, ils apprécièrent particulièrement le soin mis à scruter, dans ce riche réservoir de documentation, maints détails de facture ou de mode de jeu que seul un musicien était à même de remarquer : citons, pour la seule famille des cordes pincées, non seulement la forme, la matière ou le nombre de cordes, que chacun eût bien sûr noté, mais aussi le mode d’attache du baudrier et des cordes, la façon d’accorder ces dernières, la position du chevalet ou du sommier sur la table, la répartition des rôles entre le plectre et les doigts, la position des mains et des doigts en action, etc. Dans cet examen minutieux apparaissent des singularités auxquelles on n’avait prêté que peu d’attention, telles que la présence d’ouïes ou même de rosaces centrales sur la table d’harmonie, le constant décalage des bras sur la caisse de cithare, et surtout le rôle mystérieux de cette singulière spirale dont le dessin est trop constant pour n’être pas réel et dont on ignore non seulement le rôle , mais jusqu’à la matière, puisque aucun spécimen n’a survécue jusqu’à nous…"
| Il est difficile de préciser le rôle de ce rond noir percé de cercles blanc qui figure sur la caisse. S'agit-il d'ouïes? Dan ce cas, on peut évoquer la "rosace", cette ouïe centrale des luths de la renaissance et de l'aga baroque. Peut-être est-ce de la marqueterie? |
|
La Muse Terpsichore joue d’une harpe en étrier .L’instrument se compose d’une caisse presque verticale, arrondie en crosse à son extrémité, et sur laquelle de petits ronds équidistants figurent les rivets où s’accrochent les 9 cordes visibles (15 au total d’après le nombre de rivets). Elles ont une disposition en diagonale très favorable à l’attaque des doigts. La caisse semble constituée par deux planches accolées entre lesquelles sont fixées les cordes. Manque le support que constitue ordinairement la colonne.
|
|
… "Je me suis engagé dans l’étude systématique des instruments de musique tels qu’ils sont fréquemment représentés sur les vases grecs. La documentation est extrêmement riche. J’ai abordé l’examen de plus de 1500 illustrations du strict point de vue de l’organologie, en essayant d’en extraire les renseignements qu’elle nous fournissent sur la facture des instruments, leur jeu et même d’après leurs proportions (autant qu’on puisse en juger) leur sonorité. On peut s’interroger au préalable, sur le degré de précision que l’on peut attendre de représentation dues à des céramistes, qui n’étaient pas nécessairement des instrumentistes compétents. Mais la comparaison des nombreuses figurations de l’aulos, de la lyre, de la cithare où se retrouve les même détails, les mêmes assemblages prouve que les peintres, compte tenu de certaines négligences ou étourderie, sont dans l’ensemble fiable et même étonnamment précis. … Mais encore une fois , la masse des documents examinée avec la prudence et l’esprit critique indispensable, prouve que les peintres , vivant dans une civilisation où la musique, dès l’école, tenait une si grande place, ont en général représenté les instruments avec fidélité tant dans les proportions que dans les détails de la facture. Dès le milieu du second millénaire, le peintre du sarcophage d’Hagia Triada savait représenter en connaisseur une cithare et un elymos. En revanche, le schématisme propre aux vases de style géométrique limite considérablement la valeur documentaire d’un instrument que l’on n’utilisera guère aux époques plus récentes : La phorminx. Avec la céramique à figure noires du VIe siècle commencent les séries abondantes, variées de détails précis, des représentations d’instruments. On constate que, dès ce moment, l’aulos et la cithare sont fabriqués selon une factures qui ne variera pour ainsi dire pas dans les siècles suivants. Mais c’est avec les vases à figures rouges que, dès la fin du VIe siècle , nous abordons la documentation de beaucoup la plus sûre. Les dessins sont d’une telle finesse, les peintres animés d’un tel soucis de vraisemblance et de perfection, que la constance et la présence de certains détails de facture ne peuvent qu’être l’image d’une réalité instrumentale bien connue des artistes. La netteté des traits, l’importance des représentations musicales rendent alors possible de définir certaines lois acoustiques ou organologiques touchant par exemple à la cithare ou à l’aulos. Les céramiques apuliennes et campaniennes du IVe siècle révèlent certaines transformations dans la facture des instruments anciens et l’apparition d’instruments nouveaus, comme la harpe, instrument féminin par excellence. D’autres, bizarrement , s’hybride, telle la cithare-lyre. … Reste un problème qu’il était difficile d’aborder sans le secours d’un philologue : celui du nom des instruments, qui n’est jamais inscris sur les vases…. Un consensus s’est établi sur le fait que la lyre résonne grâce à une carapace et la cithare grâce à une caisse en bois…."
|
Les instruments a cordes La Harpe
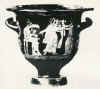 |
Concert de cithare mixte et de harpe en étrier. Les instrumentalistes sont probablement des femmes ou des Muses. La harpe de forme ovale tronquées possède au moins cinq cordes. La harpiste utilisa un plectre, ce qui fait penser qu'elle accompagne le ou la cithariste, car ce type de jeu permet avant tout un battement rythmique sur les cordes. La scène montre soit Apollon accompagné par deux muses, soit un concert au gynécée; dans ce cas la représentation d'une femme jouant de la cithare est un fait assez exceptionnel. |
 |
La panse du vase s'orne d'une harpe en étrier dont la colonne prend la forme d'un héron stylisé |
 |
Origine : L’idole de marbre de Kéros atteste l’existence dès le IIIe millénaire de la harpe trigone dans les Cyclades ; cet instrument est également représenté dans l’art de Sumer (bas relief en Calcaire (XXIV e s.), ruines sumériennes de Lagash (musée du Louvre) et de l’Egypte (peinture d’une tombe thébaine de la XVIII dynastie (New-York).
|
Ces éléments de construction correspondent à des destinations précises et donnent naissance à des types instrumentaux dont les principes organologiques différent fortement.
Selon la terminologie utilisée par Max Wegner , les harpes se classent ainsi :
Harpe en étrier harpe trigone, harpe en fuseau et la harpe naviforme.
|
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Ainsi nommée à cause de sa console en arc de cercle, se compose soit de deux pièces soit de trois. La console est le plus souvent décorée, à sa périphérie d’un ornement en forme de crête, parfois terminée par une tête d’oiseau. Rares sont les harpes dépourvues de cet ornement telle et dont la console se recourbe en forme de « crosse ». La console est parfois incrustée d’un motif en forme de perles et pirouette, de flots ou d’ornement divers.
Sa colonne est une barre solide ou au contraire une fine baguette. Sur la harpe de luxe figurée sur un cratère de Gnatthia et sur un lécythe du cabinet des Médailles, elle est exceptionnellement sculptée en forme d’échassier.
Le joug est un bois effilé ou large se terminant parfois en forme de molette. Les cordes s’y accrochent par le système de collopès , laçage ou d’anneaux. Quelquefois le joug est double. Dans ce cas, la tige supérieure sert à accrocher les cordes.
Peut-être pouvait-elle pivoter sur elle-même pour modifier leur tension. Maurice Emmanuel pense que le joug supplémentaire permettait de tendre un deuxième rang de cordes ; mais cette hypothèse est infirmées par les peintres qui ne figurent jamais rien de pareil. Il semble plus probable que la tige inférieure reposent sur la jambe gauche de l’instrumentaliste avait pour utilité de servir de support à l’instrument et par conséquent d’assurer une meilleure stabilité.
Ce type de harpe, le plus fréquent, correspond à la sambyque citée par Aristotedont l’origine paraît bien être égyptienne. Dans l’Egypte ancienne en effet, l’instrument est souvent représenté sur les monuments ; il est de taille considérable (parfois à hauteur d’homme)
La harpe trigone
Cette harpe est celle que tient la statuette de Kéros. Elle apparaît dans la céramique grecque. Le cadre est un triangle rectangle dont l’angle droit se trouve du côté opposé au musicien. La colonne et la console , étant donnée leur épaisseur, ont probablement toutes deux un rôle de caisse de résonance. Ainsi, cette harpe possédait vraisemblablement une forte sonorité.
La harpe en Fuseau
Bizarrement , la console, sorte de caisse fuselée, forme l’hypoténuse du triangle rectangle que constitue de cadre. C’est la colonne, et non plus la console, qui se trouve tenue contre la poitrine de la harpiste. Le joug est constitué d’un simple tige. Rares en sont les représentations.
La harpe naviforme
Elle est certainement d’origine égyptienne. La grande harpe fut l’instrument privilégié de ce pays, mais de nombreux spécimens de petites harpes, à manche courbe et caisse oblongue, ont été retrouvés dans les tombes.
Ce type d’instrument , intermédiaire entre le luth et la harpe, par son manche et sa caisse en nef renversée, ne figure qu’une fois sur un lécythe à fond blanc. Il est vraisemblablement l’ancêtre du luth grec dont une statuette de tanagra et le bas relief des muses de Mantinée nous ont conservé l’image. Ce type d(instrument existe encore en Afrique
Les Cordes
A l’exception de la harpe naviforme, qui en compte peu, tous ces instruments possèdent un nombre de cordes compris entre 7 et 20, le plus souvent entre 9 et 15 chiffres également réparties sur tous les modèles. Pour un ambitus de 2 octaves avec note défectives, il faut un minimum de 14 cordes. On compte de manière très approximative et on aboutit donc à une moyenne de 15 cordes pour la harpe grecque (couvrant ainsi l’ambitus de la voix humaine)
Elles sont fixés au cadre à l’aide de collopès d’anneaux ou ressorts circulaires de taquets part laçage. Toutefois on peut envisager l’hypothèse selon laquelle les taquets par rotation du joug viendraient prendre appui contre les cordes (à la façon des fourchette de nos harpes modernes.) pour en modifier la hauteur.
L’accord
Sur les harpes en étrier , le joug se coince par rotation, dans le bâti de la caisse, comme une cheville de violon dans la « crosse », sur les trigones, par laçage de chaque corde sur le joug, quant aux harpes en fuseau et harpes naviforme, on ne voit pas comment l’accord s’opérait.
Le jeu est identique à celui de nos harpes modernes. Les deux mains agissent séparément ou ensemble. Elles tirent les cordes avec les cinq doigts recourbés en éventail ou arrêtent les vibrations du plat de la main selon le geste bien connu des harpistes.
L’instrumentiste tire une corde entre deux doigts pour obtenir un claquement sec ou provoque l’émission d’harmonique (que les harpistes nomment flageolets) en plaçant le gras du pouce ou de l’index au centre de la corde, la main droite la pinçant.
L’effet spécifique du glissando de la harpe semble apparaître .On retrouve la manière dont les mains passent alternativement l’une au-dessus de l’autre pour gratter les cordes.
Le bisbigliando est peut-être suggéré .
Le jeu psalmique demeure essentiellement utilisé , mais le plectre est parfois visible.
Son rôle
On trouve la harpe aussi bien entre les mains divines des Muses, qu’entre celles de femmes vêtues (donc présumées honnêtes) et de femme dévêtues, courtisanes accompagnatrices des joies du banquet. La musique de la harpe revêt d’ailleurs un caractères nettement érotique.
Y a-t-il une spécificité dans l’usage de tel ou tel type de harpes ? Sur une vingtaine de représentations, trois sont des harpes trigones, trois des harpes en fuseau : une seule est naviforme. En revanche la harpe en étrier paraît la plus commune et la plus en faveur, elle figure surtout dans des scènes de gynécée. Quand à la harpe trigone, on l’aperçoit dans les scènes à tonalité dionysiaque, et la harpe en fuseau dans les scènes à tonalité matrimoniale, de la harpe naviforme ,représenté sur un seul vase on ne peut rien préciser sinon sa rareté. Enfin , les harpes à consoles crénelées ne figurent que sur les représentations les plus récentes, celles des vases de l’Italie méridionale du IV siècle.
Terminologie
Le nom grec de la harpe nous est inconnu. Peut-être est-ce le trigonon citée par Athénée ?
Des nombreux instruments multicordes cités par Pollux quels sont ceux qui doivent être attribués aux harpes représentées sur les vases ? Il est possible, tout au plus, d’en dresser une liste succincte.
La pectic est souvent associée à la magalis , comme elle d’origine lydienne. Elle permettrait de jouer à l’octave. Sappho passe poour avoir été la primière à s’en servir. Son diaposon étant aigu.
La magalis est d’origine lesbienne, avec 20 cordes doubles. Elle donne son nom à l’accompagnement en octave ; magaliser (Aristote)
La sambyque (ou lyrophoenix), serait la grande harpe égyptienne en croissant.
L’épigoneion à 40 cordes, le sémikion à 35 cordes permettaient d’obtenir des changements rapides de modes ) l’époques hellénistique. La nablas, harpe d’origine phénicienne possédait 12 cordes.
Il faut ajouter les termes de clepsiambe, de spadix mais quelle que soit la terminologie, les instruments à cordes nombreuses sont condamné par Platon.
Les pandoura et scindapse, luths dont aucune représentation céramiques n’est venue jusqu’à nous, ont existé puisque les sculptures témoignent de leur présences.
Tous ces instruments sont caractérisés par leur grand nombre de cordes et leur tessitures aiguë. Il n’est pas possible de les identifier de façon plausible sur les représentations céramique du IV siècle.

