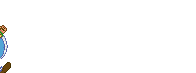|
La
Harpe en France
|
 |
|
La harpe est l’instrument de prédilection des irlandais, des Gallois, des Anglo-saxons, et cela dés les temps les plus reculés.Au Xéme siécle, les lois de Howell, un roi du Pays de Galles ne précisent-elles pas : « Trois choses sont indispensable a un gentilhomme : sa telyn, son manteau et son échiquier, mais ce qui lui est encore plus nécessaire c’est une épouse vertueuse, un coussin sur sa chaise et une harpe bien accordée. » A côtés de la musique de harpe exécutée par les bardes et sur laquelle plane beaucoup d’incertitude, il existait tout le répertoire des airs folklorique. A tous ceux qui sont intéressées par la musique des pays celtique, l’usage de la petite harpe s’impose ; les modes si riches des anciens chants s’adaptent merveilleusement à son diatonisme.L’usage de la harpe a pénétré sur notre continent, en premier lieu en Bretagne, par l’intermédiaire des missionnaires irlandais. Les XII, XIII,XIV, et XV éme siècles représentent l’âge d’or de la harpe. L’usage de l’instrument est attesté par nos chroniqueurs ; il est visible sur les enluminures, les sculptures, chez les peintres, il est mentionné fréquemment dans les pièces d’archives.Le talents des exécutant renommés avait assez d’importance pour être mentionné parmi les attraits de Paris, Gilbert de Metz, au XIV éme siècles ne craint pas d’écrire : » Grande chose était de Paris quand y vivaient Guillemain Dancel et Perrin de sens, souverains harpeurs. »Pendant de nombreux siècles, la forme, les dimensions et le nombre des cordes n’obéissent a aucun canon.A tout ceux qui veulent ressusciter les œuvres de ces périodes, une harpe de format réduit est nécessaire.Poursuivons notre brève enquête a travers les ages. Que nous propose les XVI éme et XVII émé siécles ? Une moins grande faveur, mais une existence certaine. Son impossibilité de moduler nuisait à la naissance d’une littérature propre (il y avait cependant des harpes a deux et même a trois rangs de cordes dont le doigté était très compliqué.Quelques spécimens sont parvenus jusqu’à nous , signés de luthiers italiens : il sont probablement des redites d’instruments inventés par les Gallois et les Irlandais. Les compositeurs n’écrivaient pas spécialement pour l’instrument , le harpiste choisissait parmi les œuvres celles qui lui convenaient. Il faut faire mention spéciale pour l’Espagne où elle fut pratiqué par de nombreux virtuoses. Malgré son strict diatonisme, déploré par le théoricien Juan Berludo en 1549, elle figure dans le titre de deux recueils pour orgue . L’un « lobro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela », de Venegas de Henestrosa (1557) ; L’autre « Otra de musica para tecla, arpa y vihuela » de Antonio de Cabezon (1578) Ces deux titres indiquant clairement que ce répertoire pouvant être exécuté sur l’orgue, la harpe ou la vihuela. Au XVII émé siècle, toujours en Espagne, elle jouit d’une grande faveur. Dans les grandes églises, il y avait toujours un poste de harpiste.…….Dans le concert multiforme des instruments d’aujourd’hui et de ceux qu’enfantera demain l’imagination bouillonnante de l’homme, la Harpe, surgie des confins de la préhistoire, demeurera le plus noble et le plus élégant de ses moyens d’expressions musicales...."
- Esther Lamandier: Chanteuse Soprano, spécialiste du Répertoire du Moyen-âge.
- Katrien Delavier
- Roxane Martin
- Cécile Corbel
- Christophe Saunière
- Yvon Le Quellec
 |
La
harpe en Bretagne
 |
Alan stivell
Extrait de sa biographie
" La renaissance bretonne de la harpe celtique fut entièrement l'œuvre d'Alan et de Georges/Jord Cochevelou (son père). Le coup d'envoi de cette résurrection fut donné à la Maison de la Bretagne à Paris en Novembre 1953 par les mains d'Alan,enfant (il avait moins de 10 ans), quand il fit résonner la première harpe celtique bretonne (un instrument au son inégalé) du 20ème siècle. (On a pu lire ici et là, notamment dans “Musique bretonne” de R.Becker et “Dictionnaire du patrimoine breton”, des propos erronés qui enlevaient cette paternité au binome Cochevelou; ils ont tous été rectifiés: en effet, il n'y a eu aucun début de réimplantation de la harpe celtique en Bretagne auparavant). La harpe celtique a pu se réinstaller définitivement dans le paysage musical breton dans les années 50, grâce aux efforts d Alan et de son père (cathédrale de Vannes, Unesco 1954, Olympia 1957, etc) renforcés par celles et ceux qui les ont suivi (Armelle Géraud, Soazig Noblet, etc). Les deux premiers disques consacrés à la harpe celtique furent “Musique Gaélique” et “Telenn Geltiek” (les deux sont maintenant réunis en un seul CD).
L'influence des Cochevelou s'est fait sentir dans les années 50 jusqu'en Irlande et en Ecosse où, là aussi, elle a renforcé le réveil timide de l'instrument (qui, dans ces pays, n'était pas complètement disparu). En retour, leurs amis écossais et irlandais leur ont donné accès à la musique gaélique authentique. La harpe celtique est devenu un instrument populaire dans le monde entier, principalement grâce à Alan, après qu'il eut pris le nom d'Alan Stivell à partir de 1967. Pour la première fois on vit, en télévision comme sur des grandes scènes, des grands festivals rock, un jeune homme chanter avec sa harpe bardique éléctrifiée, dans un contexte musical d'avant-garde en même temps que populaire. Le disque “Renaissance de la harpe celtique”, enregistré en 1971, suscita l'engouement qui, conjugué au travail de nouveaux harpistes, amena des centaines de luthiers à construire cet instrument, des milliers de musiciens à s'y consacrer sur tous les continents. Ce phénomène à eu des conséquences jusqu'en musique dite classique: la vogue de la harpe celtique moderne a réévalué l'image de la harpe en géneral (classique et autres) dans le monde. Ses disques consacrés à l'instrument: Telenn Geltiek, Renaissance de la Harpe Celtique, Harpes du Nouvel Age, Au-delà des mots. Musique classique, celtique ...la suite sur le site d'alan
stivell (biographie)
- Les Freres Triskell
- Myrdhin
- Mariannig Larc'antec
- Dominique Bouchaud
- Anne Auffret
- Françoise Levisage
- Anne postic
- Les fileuses de nuit
- Christine Merienne